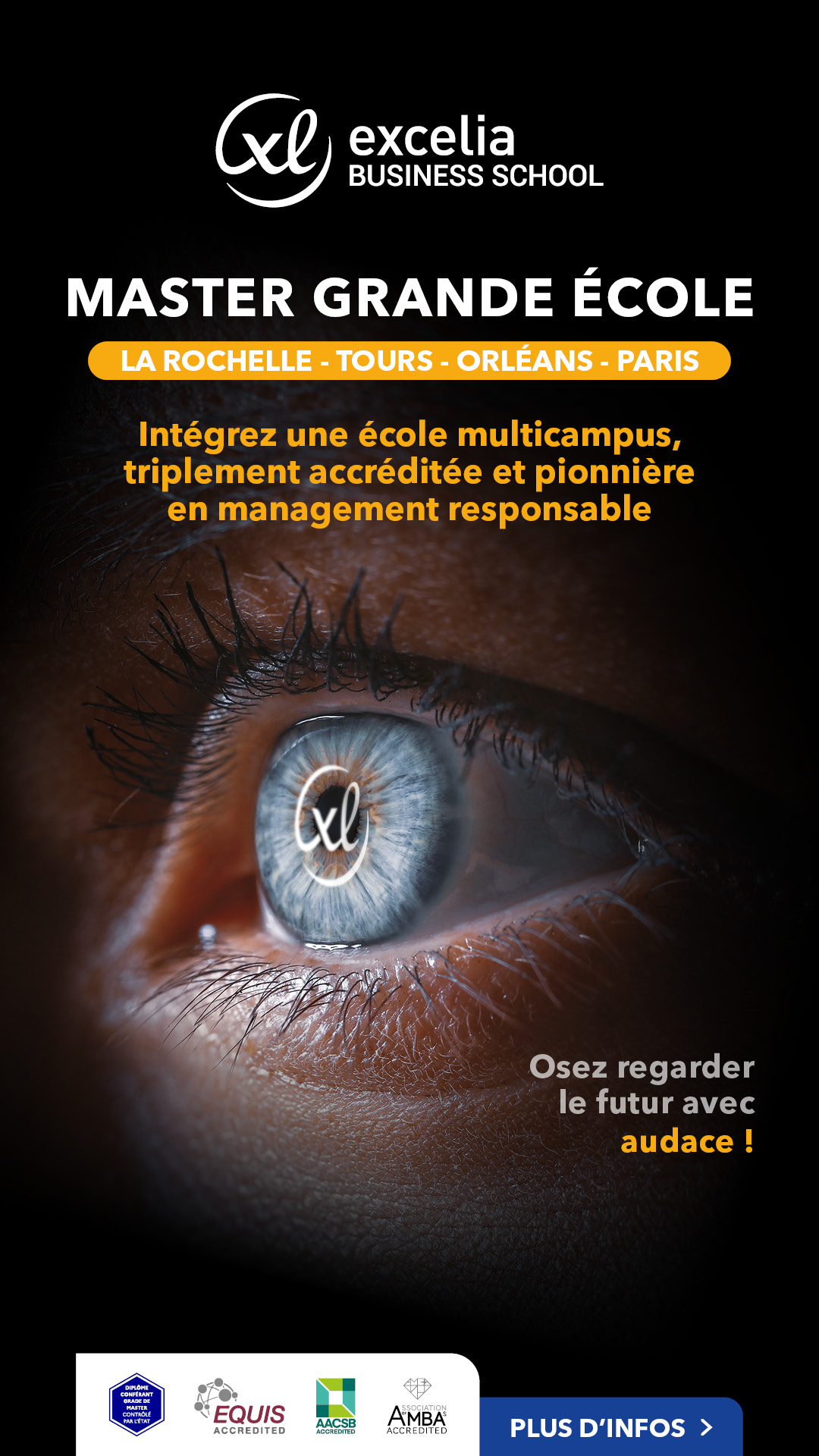À quel degré le milieu social détermine-t-il l’accès aux grandes écoles ?
Les grandes écoles sont souvent réputées comme des lieux réservés à un certain type d’élèves, issus d’un milieu social favorisé. Toutefois, les différentes mesures mises en place par les écoles de commerce pour favoriser l’ouverture sociale de leurs programmes semblent indiquer une volonté de réduire l’influence du milieu social dans l’accès aux grandes écoles.
Mais que sont les grandes écoles ? Originellement, celles-ci désignent l’ensemble des établissements garantissant une formation de niveau élevé pour les futurs fonctionnaires. Les écoles telles que Polytechnique , l’École normale supérieure , ou encore l’École des ponts ParisTech… sont à cette image. Toutefois, cette définition s’est élargie et les « Grandes Écoles » sont aujourd’hui les écoles supposées délivrer une formation de haut niveau.
Dans son ouvrage La Noblesse d’État (1989), Pierre Bourdieu met en lumière le système non seulement de reproduction mais aussi de légitimation des classes dominantes en France à travers la formation. Le système scolaire français, notamment grâce aux Grandes Écoles, permet l’avènement d’une toute nouvelle génération considérée comme légitime pour occuper le pouvoir. Ainsi, l’accès à ces écoles représente un enjeu majeur dans la société puisque bien souvent, ceux sortant de ces formations jugées d’excellence seront les leaders de demain.
Dès lors, les tentatives d’ouverture sociale menées par les grandes écoles afin de favoriser la mobilité sociale portent-elles leurs fruits ?
Lire plus : Enquête : la diversité sociale au sein des grandes écoles
Trois déterminants majeurs pour rentrer en grande école
Dans leur rapport Quelle démocratisation des grandes écoles depuis le milieu des années 2000 publié en 2021, Cécile Bonneau et Julien Frenet mesurent les données sur les étudiants des grandes écoles sur l’année scolaire 2016-2017.
La catégorie socio-profesionnelle
Après analyse, il apparaît tout d’abord de manière flagrante que les étudiants sur les bancs des grandes écoles sont avant tout ceux au profil social très favorisé. En effet, sur l’année scolaire 2016-2017, les étudiants issus de catégories socio-professionnelles très favorisées (cadres et assimilés, chefs d’entreprise, professions intellectuelles et professions libérales) représentaient environ 64 % de la promotion. Au contraire, pour ceux provenant de PCS défavorisées (ouvriers et personnes sans activité professionnelle), ils n’étaient que 9% à remplir les effectifs de ces grandes écoles.
En guise d’illustration, 72% des étudiants inscrits dans une ENS sur l’année scolaire 2016-2017 proviennent de PCS très favorisées, alors que ceux de PCS défavorisées ne représentent que 7% des effectifs.
Boursier ?
Ensuite, les deux auteurs soulignent la faible proportion d’étudiants boursiers dans les grandes écoles. La part des boursiers sur critères sociaux est un indicateur intéressant pour étudier le recrutement social de ces écoles sélectives. Grâce à leurs travaux, nous observons que la part de boursiers présente dans les grandes écoles est clairement plus faible que dans les universités (19 % contre 34 % en 2016-2017). Cet indicateur est d’autant plus pertinent que plus d’un tiers des étudiants de l’enseignement supérieur bénéficient de la bourse. Ajoutons que si l’on se penche sur les échelons de bourse (allant de 0bis , échelon le plus bas, à 7, échelon le plus haut, dont les étudiants en plus grande difficulté bénéficient), l’on voit que la hausse de la part d’étudiants boursiers que nous observons ces dernières années est avant tout tirée par la part de boursiers d’échelons 0bis et 1, qui sont les moins défavorisés.
La géographie
Les inégalités territoriales des étudiants semblent être déterminantes dans le recrutement des grandes écoles. En effet, les étudiants vivant à Paris – ou plus largement en Île-de-France – sont largement surreprésentés.
« 8 % des étudiants inscrits dans ces établissements ont passé leur baccalauréat à Paris et 22 % dans une autre académie d’Île-de-France, Contre respectivement 5 % et 17 % parmi l’ensemble des étudiants inscrits dans des formations d’enseignement supérieur de niveau bac+3 à bac+5 ».
Concernant les écoles de commerce et les ENS, cette dimension géographique est plutôt importante. En effet, respectivement 34% et 32% des étudiants sont Parisiens ou Franciliens. Ce phénomène de concentration géographique est croissant avec la renommée de l’école.
« en 2016-2017, les bacheliers Franciliens constituaient entre 44 % et 57 % des effectifs inscrits à l’École polytechnique, HEC, l’ENS Ulm et l’IEP Paris et, dans les trois premières écoles, on comptait près d’un quart de bacheliers parisiens ».
Conclusion
En somme, il apparaît que le milieu social d’origine a une importance significative dans l’accès aux grandes écoles, et ce malgré les tentatives d’ouverture sociale de ces mêmes grandes écoles (Cordées de la réussite, PQPM…). Toutefois, gardons à l’esprit que la part des boursiers dans les rangs des grandes écoles continue de s’accroître, même si cette part reste toujours insatisfaisante. Les grandes écoles quant à elles semblent prendre en considération cet enjeu, comme l’illustre par exemple l’exonération du point de pénalité à HEC pour les cubes boursiers.
Lire plus : L’ouverture sociale dans les écoles de management : L’exemple de MBS